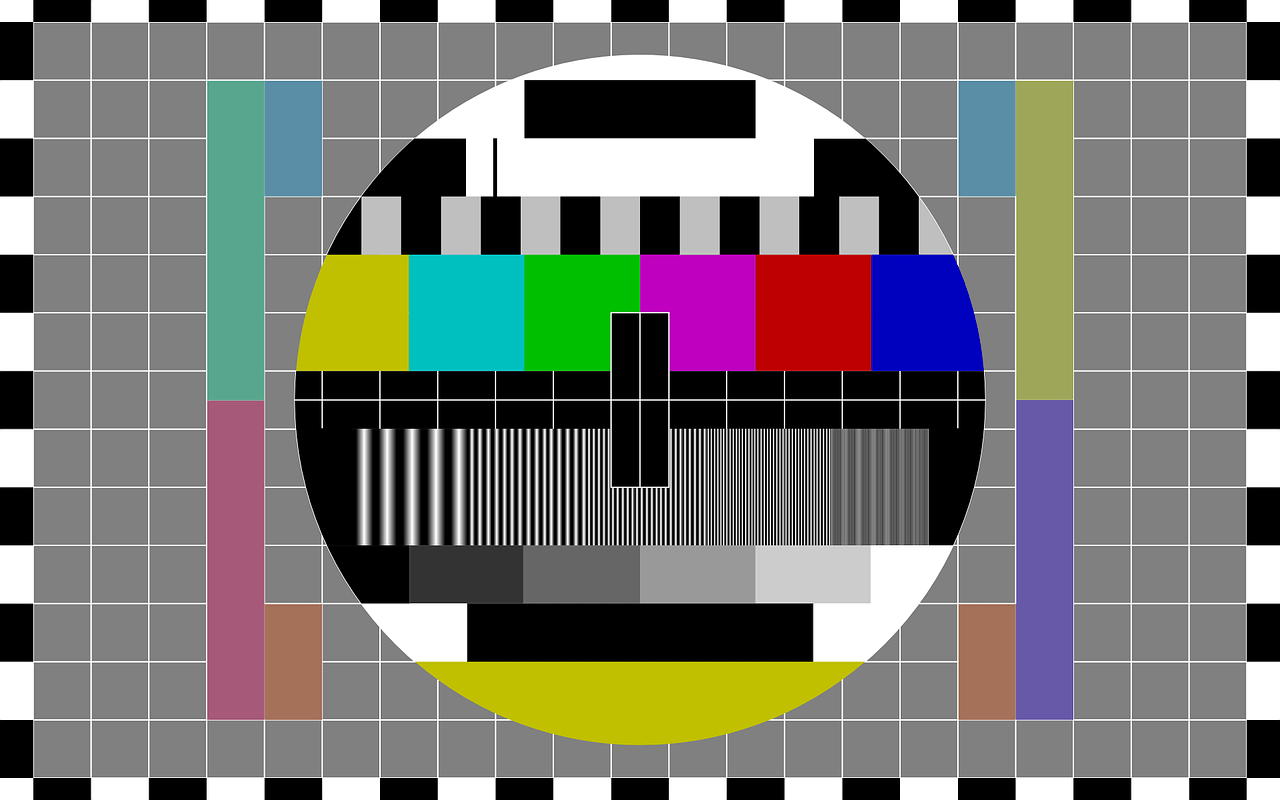La production vidéo professionnelle ne se résume pas à brancher une caméra et appuyer sur “live”. Entre le capteur et l’écran du spectateur, le signal traverse une chaîne complexe, souvent invisible, mais essentielle : c’est ce qu’on appelle le parcours glass-to-glass. Dans cet article, nous détaillons chaque étape de cette chaîne – de l’acquisition à la restitution – en mettant en lumière les points critiques, les protocoles utilisés (SRT, NDI, ST2110…), et les différences fondamentales entre les solutions Pro-AV et les standards broadcast. Un guide indispensable pour comprendre pourquoi la vidéo sur IP ne s’improvise pas.
Dans les débats autour de l’avenir du broadcast, beaucoup d’intervenants imaginent qu’il suffirait de brancher une caméra HDMI, d’ajouter un petit encodeur, et de diffuser vers un écran pour faire de la télévision. Mais la réalité est tout autre. Entre le verre de la caméra (glass) et celui de l’écran du spectateur, le signal traverse une multitude d’étapes critiques, techniques, parfois invisibles, mais pourtant essentielles à une production fiable et professionnelle.
Ce qu’on appelle le parcours “glass-to-glass” (voir aussi la video WebTVPro https://youtu.be/fMqoxwC8vdM) peut se découper en 6 étapes majeures, chacune représentant une part plus ou moins importante de complexité technique. On retrouve ce parcours aussi bien dans monde du broadcast, dans le monde AVPRO, et aussi dans le monde du streaming. Voici une analyse détaillée.
📊 Tableau de complexité : les 6 étapes du “glass-to-glass”
| Étape du signal vidéo | Description | Complexité technique (%) |
|---|---|---|
| 1. Acquisition | Capteurs, formats natifs, synchronisation caméras | 10 % |
| 2. Contribution / Transport | Transmission via IP, satellite, 4G/5G, encodage, sécurité | 30 % |
| 3. Traitement en régie | Commutation, audio, graphismes, multi-cam, synchronisation | 20 % |
| 4. Encodage / Multiplexage | Codecs, latence, TS, métadonnées, sous-titres, monitoring | 15 % |
| 5. Distribution | CDN, opérateurs, bande passante, QOS, redondance | 15 % |
| 6. Restitution utilisateur | Box, navigateurs, compatibilité codecs, affichage à l’écran | 10 % |
🔍 Analyse étape par étape
1. Acquisition (10 %)
C’est le point de départ. On capte l’image via une caméra professionnelle (ou non), avec un soin particulier sur la colorimétrie, la dynamique, le traitement natif (Log, RAW…). On veille aussi à la synchronisation des caméras entre elles, au format de sortie (SDI, HDMI, IP), et à la stabilité physique de l’ensemble. Cette étape est généralement bien maîtrisée grâce à l’industrialisation des outils, mais elle reste sensible dès qu’on est en mobilité ou en direct.
2. Contribution / Transport (30 %)
C’est le segment le plus critique. Le signal doit être transporté depuis le lieu de captation vers une régie (locale ou distante), en traversant souvent des réseaux non garantis : fibre, IP, satellite, 4G/5G. C’est ici qu’interviennent des protocoles comme SRT, RIST, NDI, ST2110 ou des solutions propriétaires comme LiveU, Haivision ou TVU. Il faut assurer la redondance, la qualité de service, et parfois rattraper une gigue ou des paquets perdus. C’est aussi là que les solutions Pro-AV montrent leurs limites : elles ne sont souvent pas conçues pour ces situations extrêmes.
3. Traitement en régie (20 %)
Une fois le signal arrivé, il faut le traiter : bascule caméra, overlays graphiques, mixage audio, retours, monitoring, enregistrement. Dans le cas d’une régie IP, la gestion des flux, du tally, de la synchronisation inter-entrées et du timecode devient complexe. C’est aussi là que se jouent les problèmes de synchronisation audio/vidéo, ou de compatibilité de formats entre équipements.
4. Encodage / Multiplexage (15 %)
Avant diffusion, le signal doit être encodé dans un format adapté au transport final (H.264, HEVC, AV1…), encapsulé dans un flux TS ou HLS/DASH, parfois segmenté. C’est ici que la latence se joue, que les problèmes de GOP, de sous-titres ou de métadonnées peuvent apparaître. Ces erreurs sont souvent invisibles à l’œil nu… jusqu’à ce qu’un player refuse de lire le flux ou qu’un CDN dysfonctionne.
5. Distribution (15 %)
Une fois encodé, le signal est remis à un opérateur (TNT, satellite, IPTV) ou à un CDN (YouTube, Akamai, Wowza, etc.). Il faut assurer la redondance géographique, les performances réseau, le respect des normes, les règles de QOS… sans compter les obligations contractuelles si une image ne passe pas correctement à l’antenne.
6. Restitution utilisateur (10 %)
Dernière étape : la restitution chez le téléspectateur. Ce sont les box, navigateurs, téléviseurs connectés, applis mobiles. Là encore, une mauvaise compatibilité HDCP, EDID ou codec peut empêcher l’image d’apparaître. C’est souvent là qu’on découvre trop tard qu’un détail négligé dans les étapes précédentes crée un bug incompréhensible à l’écran.
🎯 Ce qu’il faut retenir
- La vraie complexité ne se voit pas : ce n’est pas la qualité visuelle qui garantit la solidité d’une production, mais sa robustesse de bout en bout.
- Le Pro-AV couvre souvent les premières étapes, mais dès qu’on parle de multi-flux, de transport critique, de diffusion broadcast ou OTT à grande échelle, l’expertise des acteurs historiques du broadcast reste indispensable.
- La chaîne complète doit être pensée dès le départ, car la moindre faille dans un maillon peut avoir un effet domino.
👉 Besoin d’un accompagnement stratégique pour fiabiliser vos workflows vidéo ou réussir votre transition vers l’IP ?
Découvrez comment AVPRO peut vous aider à construire une architecture robuste, adaptée à vos enjeux de diffusion et de production.
➡️ En savoir plus sur notre accompagnement
- Qu’est-ce qu’une Media Factory ? Une nouvelle vision pour les territoires - 30 novembre 2025
- Pourquoi une télévision locale est essentielle : l’impact de TV Lunel sur le territoire et ses décideurs - 29 novembre 2025
- La vidéo sur IP n’est plus une option. - 12 novembre 2025